Un jour que je m’attardais à contempler les iconographies d’un livre sur l’Alchimie, je fus fortement impressionné par nombre de symboles me rappelant ma jeunesse et l’époque de ma scolarité dans des établissements catholiques.
Ces mots, ces images, m’ont propulsé en des zones du passé, en des référentiels philosophiques et religieux surannés. Et pourtant du fond de ce passé trois symboles particulièrement représentés agitèrent mon esprit. Je veux parler de la Croix suivie du Centre et de la Rose s’y épanouissant.
Envisageons le symbole de la Croix.
La Croix est un signifiant d’une extrême richesse, symbole universel, posant magistralement la question de l’existence humaine.
Elle est orientation dans l’espace et référence aux quatre points cardinaux.
Elle pose l’assise, le être là, la situation par rapport à l’espace terrestre et céleste.
Elle symbolise à travers le croisement, la croisée des chemins.
Cette croisée des chemins toujours inquiétante, car où aller ?
A droite ?
A gauche ?
En haut ?
En bas ?
Et se font jour doute et ambivalence.
Oui, la bifurcation, la divergence, créent le risque de division psychique.
Le carrefour symbolise pour l’homme le danger de la perte de l’unité, il est suspecté d’être hanté par de redoutables esprits maléfiques.
L’aspect terrifiant est lié à l’ambivalence qui fragilise l’homme et le rend vulnérable.
D’où ces chapelles, ces monuments, ces offrandes, pour neutraliser ces forces démoniaques.
Mais ces entités pouvaient aussi absorber les énergies négatives de l’homme divisé, de l’homme fendu par son ambivalence, et ainsi le débarrasser de ses souillures.
Parfois ordures et immondices étaient déposés là comme pour exorciser ou neutraliser les turpitudes humaines.
Hécate ou la déesse des carrefours.
La déesse Hécate était la déesse des carrefours, d’essence lunaire, elle figurait l’existence humaine, elle était aussi la déesse de la fertilité et des germinations.
Dans son aspect redoutable et infernal, elle était associée aux spectres, aux fantômes et monstres épouvantables.
Charnière entre les mondes inférieurs et supérieurs, elle représentait le carrefour entre les enfers, le monde ici-bas et le Ciel.
Donc la déesse Hécate montre bien en ce lieu, un homme fragilisé et vulnérable, en proie au doute et à l’ambivalence, et sur le point de poser un acte.
Cet acte revêt une allure dramatique et tragique car il va engager l’homme non seulement sur le plan terrestre mais aussi sur celui de l’axe vertical de l’éthique et de la Loi.
En effet, va-t-il se rapprocher un peu plus du monde inférieur et s’enfermer davantage dans le monde matériel ?
Ou va-t-il, au contraire, s’élever vers le monde de la conscience lumineuse et idéale que représente l’Olympe ?
A Hécate on peut assimiler le dieu grec Hermès.
Ainsi l’acte au carrefour engage la valeur morale de l’homme et questionne son être.
Le dieu Hermès.
Hermès est une divinité qui, comme Hécate, oscille sur l’axe vertical.
Comme Hécate il est le messager entre les profondeurs de la Terre et le Ciel.
Comme Hécate il était honoré aux carrefours où se dressaient ces cubes ithyphalliques à tête humaine, pour montrer le bon chemin.
Ainsi Hermès, le messager des dieux en personne, ayant pour attribut ses sandales ailés pouvait, à son gré, s’élever vers les nuées célestes de l’Olympe ou s’abaisser vers les profondeurs sombres de l’Erèbe !
Et c’est cet abaissement du Ciel vers la Terre, cette chute rappelant celle de Lucifer, qui a altéré son image.
En effet Hermès, dit parfois protecteur des voleurs et des menteurs, parfois escroc et suspecté d’habileté malicieuse ou de roublardise invétérée, ce dieu donc fut assimilé à une certaine forme de dénaturation voire de pervertissement intellectuel.
Abraham Karl et le fondement de la Loi.
Un psychanalyste du nom de Karl Abraham a particulièrement analysé cette question du carrefour et de l’ambivalence.
La réflexion d’Abraham va concerner un célèbre carrefour, le carrefour même de la tragédie grecque mettant en scène un héros non moins célèbre qui va incarner le refus de la Loi.
Il observe que la naissance du système patriarcal lié aux conceptions religieuses d’un Dieu masculin et paternel va dès lors impliquer une certaine attitude des fils par rapport à leurs pères.
Naturellement ou originellement la préférence du fils allait vers la mère et l’hostilité pour le père était de mise.
Mais dès lors la culture va exiger du fils le renoncement à sa mère et la fin de l’hostilité envers le père.
Et ce qui est exigé du fils envers le père le sera tout autant envers le Dieu des juifs.
Abraham remarque que le mot doute n’existe pas dans l’hébreux des écrits bibliques, c’est-à-dire qu’il n’existe pas pour la langue même qui aurait conçu le monothéisme.
Le mot doute n’existant pas aucune hésitation ne serait tolérée quant à l’adoration d’un dieu ou d’une déesse.
Abraham poursuit et observe que le mot doute est proche de la structure du mot deux.
Et les mots doute et deux en rejoignent un troisième qui est le mot fendu.
Le doute et l’ambivalence rendent l’homme fendu !
Il est vrai que dans cette région le doute et l’hésitation entre les cultes de Jahvé et ceux de Baal et d’Astarté furent constants.
Le Dieu masculin et paternel des juifs implique une position claire et non ambivalente du fils à l’égard du père.
Donc le carrefour, la croisée des chemins, est bien le lieu par excellence symbolisant la vulnérabilité et la fragilité humaine prompte à renier ses engagements.
C’est l’espace même, opposé à l’enceinte sacrée protectrice, susceptible de générer les manquements à la Loi.
Sophocle où l’envers de la Loi.
Sophocle met en scène admirablement l’aspect décisif du carrefour pour le destin de son héros Œdipe.
C’est là qu’il figure magistralement, en ce lieu funeste, la rencontre, le meurtre et l’accomplissement œdipien du retour à la mère.
Sophocle nous montre l’envers de la Loi hébraïque.
Le fils tue le père et prend la mère.
Transposé en langage hébraïque cela signifie qu’il renonce au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob pour revenir aux divinités maternelles et en l’occurrence à Astarté-Aphrodite.
Ce point de la tragédie grecque met en scène, à travers la question de l’ambivalence, l’histoire d’un parricide.
Le meurtre du père par le fils ouvrant la voie de l’inceste mère-fils.
Derrière cette question se profile celle de l’intégration de la Loi du Père (Jahvé pour les juifs, Zeus pour les Grecs). Il faut choisir ou la Loi, ou la fusion mère – fils figurant l’immersion sans règle dans la materialité.
Le point de vue anthropologique.
Il existe dans l’histoire de l’humanité une question incontournable qui est celle du meurtre.
Il semblerait que dans les temps les plus reculés de l’humanité primitive, le père ou l’entité correspondante à ce vocable, exerçait sa toute-puissance, usait et abusait des femelles tout en asservissant les jeunes mâles.
Puis un fils, avec la complicité tacite de sa mère, tua le père et pris le pouvoir jusqu’à ce qu’il soit déchu à son tour par l’un de ses fils.
Freud, pour sa part, évoque le meurtre de ce père tout-puissant de la horde primitive par ses fils et voit dans la solidarité des frères meurtriers la naissance de la vie sociale et de la civilisation.

Le repas totémique, la consommation même du corps paternel, venait attester la responsabilité collective et assumée du meurtre par les fils.
Ce repas ayant pour but la déculpabilisation des fils aurait été un élément fondateur de la fraternité.
A partir de là on arrive à la notion de Roi/sacrés rituellement sacrifiés afin de permettre la régénération de la nature.
Le roi sacré était le propre fils de la reine mis à mort rituellement afin de permettre sa succession comme cela apparaît dans les mythes grecs.
Donc le fils devient roi en tuant le père.
La mythologie grecque met en scène clairement cette question du meurtre des pères par les fils et nous montre Chronos castrer et tuer symboliquement son père Ouranos avant de subir le même sort de la part de son fils Zeus.
Mais avec l’avènement des sociétés patrilinéaires, l’homme dorénavant, comprend que les naissances sont liées au coït, que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, que la conception magique du monde n’est plus valide.
Il va désormais abandonner les conceptions religieuses liées aux divinités maternelles et notamment à celles qui concernent Cybèle, la Grande-Mère des dieux et des hommes.
Dès lors ce qu’il faudra absolument éviter c’est le meurtre du père par le fils.
Et c’est d’ailleurs avec l’avènement des sociétés marquées par la suprématie masculine que l’on assiste à de curieux meurtres d’enfants et notamment d’enfants mâles premiers nés.
Donc le carrefour est bien le lieu de l’hésitation entre ;
Le meurtre du père par le fils et le refus de la loi paternelle.
Ou du meurtre du fils par le père qui va ainsi assoir sa suprématie incontestable.
Cette suprématie coïncidant avec la reconnaissance d’un Dieu masculin et paternel, Jahvé pour les juifs et Zeus pour le monde indo-européen.
A propos de ce choix, on peut remarquer que la religion chrétienne met en scène de façon indéniable le sacrifice du fils sur la croix.
Mais avec l’évolution des temps la résolution du conflit, dans les structures patrilinéaires, va s’orienter vers le meurtre symbolique du fils.

Et il faut bien comprendre que la notion de sacrifice tourne autour de la représentation fantasmatique de l’inceste mère-fils figurant l’excès de materialité.
Donc nous sommes à ce point du sacrifice.
Le meurtre va devoir se déplacer et sortir des aires de culte pour s’intérioriser et devenir un meurtre symbolique.
La capacité au sacrifice intérieur va conditionner notre positionnement sur l’axe vertical, axe éthique de la conscience.
Le fils qui sera sacrifié n’est plus un être de chair et de sang mais une idée, une représentation mentale.
La Loi va dorénavant s’appliquer sur la gestion des représentations.
L’idée ou la représentation mentale va être traitée comme un rejeton, comme un fils, du psychisme.
Car le psychisme figuré par le contenant utérin accouche de ses idées comme autant d’enfants.
Et cet axe symbolique nous ramène au lien fusionnel mère- enfant.
Et l’action du père internalisé ou mentalisé va être de couper cette liaison.
C’est ce que l’on appelle la fonction symbolique d’interposition.
Le sacrifice va s’appliquer aux représentations.
Ce qui va être sacrifié ce n’est pas la reconnaissance et l’acceptation de la représentation mentale.
Ce qui va être sacrifié n’est pas non plus la charge de désir de cette représentation. Car elle doit être reconnu dans sa nature fondamentale de représentation d’un désir naturel.
Ce qui est sacrifié, c’est uniquement ce qui est suspecté d’être envahi par la fantasmatique œdipienne, c’est-à-dire l’intentionnalité qui constitue l’attachement à la représentation et le rajout de l’ego sur cette représentation naturelle.
Les fonctions intellectuelles qui s’assignent pour objectif fondamental la volonté de substituer l’ego, et ses rejetons, à la suite des représentations naturelles est cela même qu’il faut sacrifier.
Car dans ce type d’attachement à la représentation a été identifiée par la masse infinie des générations précédentes ce qui fonde l’amour univoque de la materialité.
Jung n’invoque-t-il pas l’Intellect correspondant à cette attitude du nom infamant de Méphistophélès ?
A ce point de la démonstration et pour mettre en exergue la question du choix en ce lieu funeste du carrefour, nous allons évoquer la voie du serpent dans le mythe du paradis terrestre.
Adam et Eve et la Chute.
En préambule rappelons que l’axe horizontal est l’axe de la terre, l’axe des besoins de la vie prosaïque, l’axe du « monde », l’axe de la materialité.
L’axe vertical est l’axe symbolique, axe de la transcendance, axe de la voie du Ciel.
L’homme est écartelé sur ces deux axes.
Le serpent est l’animal le plus horizontal, il fait corps avec la terre, point de pattes, rien qui lui permette de tenir la verticalité.
C’est pourquoi il représente si parfaitement l’axe horizontal.
Cet animal est donc celui qui va jouer un rôle central dans le mythe fondateur de la chute de l’humanité originelle, chute qui sera le paradigme même du mauvais choix.
C’est le serpent qui tend à Eve le fruit défendu.
Ce fruit défendu est le fruit de l’Arbre de la connaissance du Bien et du Mal que l’homme en aucun cas ne doit manger.
Dans l’Eden, en effet, il n’y a aucun interdit fait à Adam et Eve.
Le seul interdit exigé par Dieu est de ne surtout pas manger du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal.
Car par opposition à l’Arbre de Vie, également présent dans l’Eden, les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal donneraient la mort, c’est-à-dire la mort psychique.
De quel ordre serait cette connaissance interdite du Bien et du Mal que désirerait l’homme et qui lui coûterait l’essentiel à savoir son âme, son être ?
Il semblerait que l’interdit résiderait pour l’homme à vouloir être l’égal des dieux, à déterminer par lui-même ce qui est bien ou mal, à être son propre système de référence. Ainsi il s’éloignerait d’une certaine innocence liée à une façon naturelle de vivre.
En suivant simplement ses pulsions naturelles l’homme serait plaisant à Dieu.
Et Dieu, dans ce texte sémitique d’origine akkadienne, incarne ou métaphorise en quelque sorte la loi naturelle. Cette loi amène la jouissance certes de tous les biens terrestres mais aussi et surtout de biens d’un autre ordre qui conditionneraient l’harmonie et la joie suprême.
C’est cette harmonie, c’est cette joie, qui font justement que l’on parle du Paradis terrestre et non pas d’autre chose comme par exemple l’enfer !
Être au Paradis c’est mener une vie simple et naturelle, source d’une joie immense.
Cette vie-là étant conditionnée par des occurrences psychiques elles-mêmes simples et naturelles.
Manger du fruit défendu c’est quitter cette vie simple et naturelle, pleine de béatitudes, pour s’élancer sur la voie des représentations inauthentiques, inobjectives et factices.
Manger la pomme du serpent c’est refuser l’harmonie pour choisir une vie complexe issue d’une activité mentale où les formations de désirs vont se substituer progressivement aux occurrences naturelles.
C’est la voie de la matérialité effrénée et des désirs débridés.
Voie qui aboutit irrémédiablement à la destruction des possibilités qu’avait l’homme, avant la chute, de jouir des biens permettant d’acquérir bonheur et sagesse.
Le choix de l’avoir, dès lors, invalide la possibilité d’être et précipite vers la sortie de l’Eden.
La voie du serpent induit donc un fonctionnement intellectuel vicié qui pousse l’homme à vouloir toujours plus, à désirer plus que son propre désir, à exploiter les ressources de la terre, à piller, spolier, détruire et asservir. La voie du serpent c’est ne plus être « à l’image de Dieu », comme le dit la Genèse, mais être dieu sur terre.
Il faut maîtriser la matière, la connaître par la ruse de l’intellect pour être comme des dieux.
Prométhée ou la ruse de l’Intellect.
C’est ce fantasme fou qui a décidé Zeus de punir Prométhée pour avoir volé le feu des dieux et le donner aux hommes.
C’est ce feu de la métallurgie, des cyclopes à la vision univoque, qui a donné les socs, certes, de l’agriculture mais aussi le bronze des armes.
Pour Zeus c’était à l’homme lui-même de découvrir le feu, mais le feu intérieur, le feu de son âme.
Au lieu de cela Prométhée a livré à l’homme le feu du Ciel, feu indu, feu illégitime, qui dans des mains impies est devenu le feu destructeur du serpent.
Oui l’homme, porte-étendard du feu du serpent, idolâtrant dramatiquement la raison, oubliant les valeurs d’une intuition unitive, perd progressivement l’accès à son être.
La question du choix posée par la Genèse sémitique avec Adam et Eve se retrouve néanmoins dans d’autre conceptions mythiques.
Une autre figure de la mythologie, celle de Sisyphe, peut mieux nous aider à comprendre cet enjeu.
Sisyphe où le projet fou d’élever ses turpitudes jusqu’au Ciel.
Sisyphe nous montre que le projet d’attachement forcené aux biens de la Terre et aux représentations du monde rend impossible l’ascension sur l’axe vertical de la transcendance.
En effet il roule une énorme pierre symbolisant la force de ses envies sur le flanc d’une montagne espérant malgré tout en atteindre le sommet.
Et se produit l’inévitable, la force gravitationnelle de l’attachement démesuré fait que la pierre brusquement dévale et retourne dans les bas-fonds.
Cette question de la dénaturation de la Psyché et son orientation vers une forme dégradée de fonctionnement ne permettant plus une vision unitive et harmonieuse de la Réalité a été abordée par nombre de philosophes ou de systèmes philosophiques.
Parménide, un philosophe grec, a particulièrement réfléchi cette question.

Parménide et la question fondamentale de l’être.
Dans son poème « Sur la nature ou sur l’étant », Parménide énonce un fait capital.
Il affirme que ce n’est pas l’énoncé ou l’opinion (doxa) qui importe mais une disposition générale, une attitude intérieure, qui se résume par le qualificatif d’être.
Pour Parménide pouvoir penser véritablement implique être.
Et être n’exige aucun contenu, aucune rectitude de l’énoncé, aucun accord du discours sur le réel, mais simplement une façon d’être.
Être, dit-il, écarte du chemin tortueux des réflexions stériles sur ce qui n’est pas.
Être permet de renoncer à la voie « … où errent sans rien savoir les mortels à deux têtes », courant « droit devant leur poitrine leur pensée errante, ils se laissent porter aussi muets qu’aveugles, effarés, race qui ne distingue pas…».
On a compris que Parménide évoque l’ambivalence de ceux qui manie l’opinion, la doxa, sans connaître l’être.
Pour Parménide la pensée vraie a pour préalable la question ontologique.
Et pour s’assurer que tout le monde a bien compris Parménide qualifie toute son œuvre, tout ce qu’il a écrit sur le monde en tant que phusikos (philosophe de la nature), de fatras d’opinions certainement dépassées.
Parménide nous montre le chemin en se détachant de sa propre œuvre, en nous montrant qu’il est capable de rompre avec son propre système de représentations afin de rester fidèle à l’essentiel pour lui, son être.
Quand on évoque la voie du serpent et la prise d’un chemin qui éloigne du bonheur on ne peut que penser à l’école épicurienne et à son Jardin.
Epicure où le plaisir naturel.
La voie d’Epicure est de mener à la sérénité, à la tranquillité de l’âme ou ataraxie.
La pièce maîtresse de sa philosophie est le plaisir qu’il définit comme absence de troubles et de douleurs.
La pratique préconisée ici aussi est de satisfaire aux besoins naturels qu’ils soient nécessaires ou non.
Donc on rejoint là la conception d’une jouissance naturelle des désirs et des biens de la terre.
Les autres jouissances sont taxées par lui de vides dans la mesure où elles naissent d’opinions fausses qui sont source d’angoisse.
En tout cas la voie du bonheur tient à la modération, c’est en quelque sorte la voie du milieu des philosophies extrême-orientales.
Il faut éviter aussi les plaisirs qui vont être source de déplaisir car générateurs de douleurs physiques ou de perturbations, de troubles de l’esprit.
Pour ne pas souffrir il faut donc mener une vie droite et sans inquiétude.
Pour être heureux il faut être juste, s’exercer à la sagesse et évacuer les opinions fausses source d’angoisse et qui mettent en péril l’ataraxie.

Les stoïciens où le travail sur les représentations.
Les stoïciens, quant à eux, ont attirés notre attention sur ce qui nous est propre.
Quelle est la seule chose qui nous appartient ?
La seule chose qui nous appartient est l’idée qui vient ici et maintenant.
Une idée vient…,
Elle est vraie disent-ils.
Qu’est-ce qu’une idée vraie ?
Une idée vraie est une idée objective, répondent-ils.
Qu’est-ce qu’une idée objective ?
Une idée objective est une idée qui permet de saisir la Réalité.
Ou encore une idée objective est une idée qui permet strictement de percevoir la réalité sans rien y ajouter.
A ce propos Descartes propose le terme d’idées innées pour caractériser les idées provenant de l’équipement neurobiologique.
En effet il oppose aux idées adventices ou authentiques les idées « factices » crées par notre imaginaire qui se rajoutent sur les représentations objectives.
L’essentiel pour les stoïciens est donc de rester sur les suites de représentations vraies sans les dénaturer par les rajouts imaginaires.
Ils évoquent une sorte de discours intérieur, issu de l’ego et de sa « folie » d’attachement, qui se grefferait sur les représentations pour les déformer et les dénaturer.
C’est la somme de ces ajouts qui empêcherait l’homme d’atteindre à la connaissance vraie et au bonheur qui s’y rattache.
Pour Epictète ce qui nous trouble ce ne sont pas les choses mais nos jugements sur les choses et nos faux-discours.
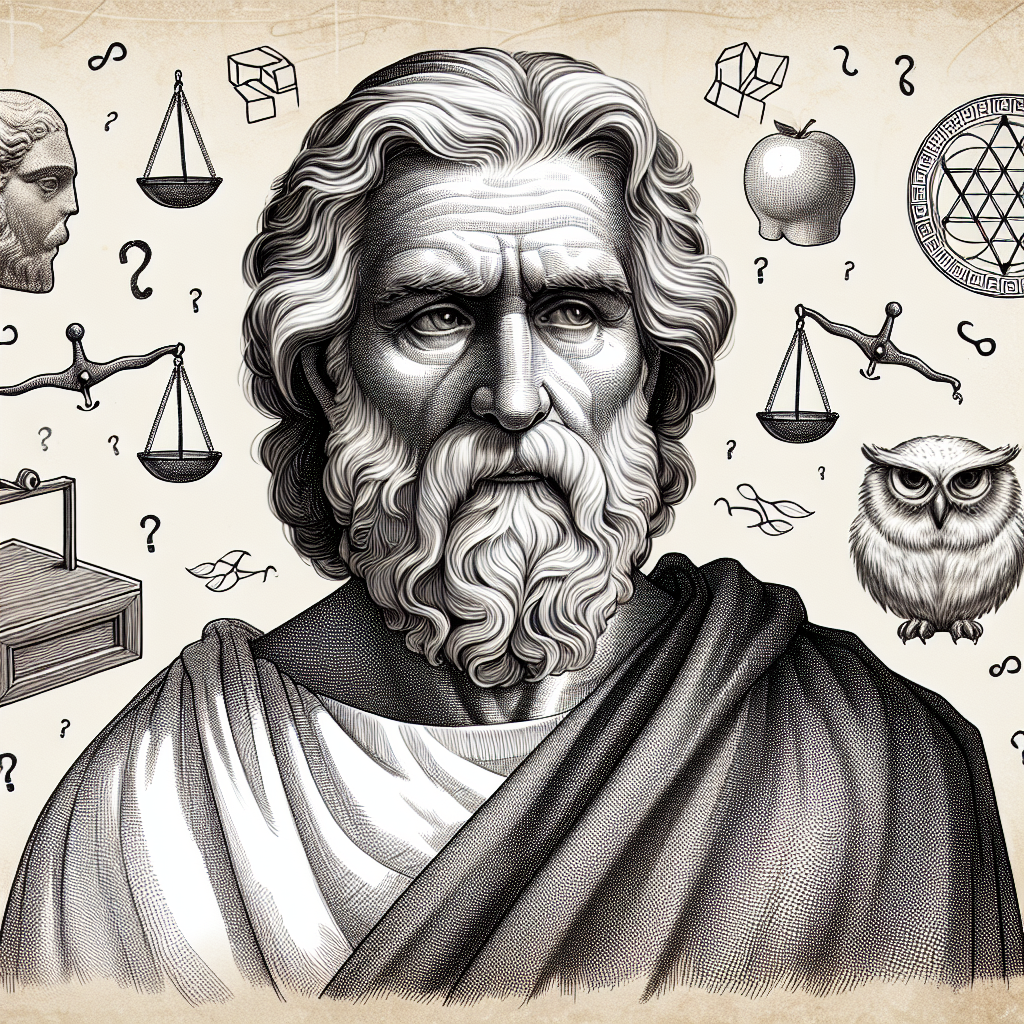
La question des faux-discours nous amène naturellement à la réflexion des sceptiques.
Le scepticisme où le refus de coller des jugements sur la représentation objective.
Les sceptiques ont apporté une colossale contribution à cette question de l’activité mentale juste.
Ils ont pratiqué la suspension du jugement dans le but de ne pas plaquer sur les représentations objectives de la perception des idées fausses.
Husserl a magnifiquement développé la méthode sceptique pour théoriser ce qu’il appelle la réduction phénoménologique qui permet là encore, par la non projection de nos jugements sur l’objet, de pouvoir contempler ce dernier sans préjugé.
La réduction phénoménologique métaphorise bien la question du sacrifice.
Nous rappelons que Descartes est un précurseur de la phénoménologie et l’œuvre de Husserl intitulée Les méditations cartésiennes en atteste.
Pour rester sur les phénoménologistes nous allons évoquer Heidegger et sa réflexion sur la question de la vérité.
Heidegger et l’essence de la vérité.
Une excellente métaphore sur la vérité est celle à laquelle nous convie Heidegger dans un texte intitulé « De l’essence de la vérité – Approche de l’allégorie de la caverne ».
Heidegger reprend au cœur la question que pose Platon. Quelle est l’essence de la vérité ?
Pour lui l’expérience grecque initiale de la vérité serait contenu dans la structure même du mot grec pour vérité soit άλήθεια(aletheia).
Le mot grec initial pour dire la vérité signifierait ouvert et sans retrait.
Quelque chose de vrai serait de l’ordre du mot grec άληθέςsans retrait.
Quelque chose de faux serait en retrait.
Pour les grecs quelque chose de vrai serait libéré d’une autre chose qu’il aurait dessus.
Quelque chose de vrai serait libéré de quelque chose d’autre rajouté.
Et toute la nuance est là.
Dans la définition grecque initiale du mot vérité il n’y a aucune référence à un discours qui serait en adéquation avec la chose. Il n’y a non plus aucune indication quant à une connexion de l’énoncé avec le réel, d’une mesure ou d’un accord, aucune allusion non plus à une rectitude de l’énoncé.
On est dans la droite ligne du propos de Parménide.

Pour Heidegger ce mot de ά-λήθεια (aletheia) est en lien avec l’essence même de l’homme, avec ce que Heidegger appelle le Dasein de l’homme, c’est-à-dire avec l’expérience fondamentale du fait d’être là.
Ce qui était άληθές pour les grecs signifiait simplement une façon d’être au monde.
Manifestement en retrait dans sa vie et ses habitudes l’homme est celui dont la quête est d’atteindre au hors-retrait, à l’άλήθεια(aletheia).
Et la façon d’atteindre au hors retrait implique que rien ne soit ajouté sur les représentations objectives des stoïciens ou les représentations adventices de Descartes.
En Asie, un philosophe a particulièrement analysé ces fluctuations de l’âme entre ses aspects inférieurs et supérieurs, et ce philosophe n’est autre que Confucius.
Confucius s’est appliqué à forger le concept de voie naturelle comme le met en exergue cette phrase ; « La loi que le Ciel a mis dans le cœur des hommes, l’observation de cette loi s’appelle la Voie. Tout homme porte en soi cette loi par sa conscience ».
Une petite digression pour exprimer le fait que cette phrase fait irrémédiablement penser à une autre phrase, d’un philosophe occidental cette fois, Kant en l’occurrence, et qui est ; « Deux choses me remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération, toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ».
D’où vient le mal si l’homme est naturellement bon ? Telle est la question que pose Confucius en substance.
Et il répond que le mal naît dans le cœur de l’homme par erreur d’appréciation.
Socrate répondrait par ignorance, Epicure par opinions fausses, et les stoïciens par faux discours.
Il semblerait que l’appréciation nécessaire à l’établissement d’une jouissance juste et naturelle des biens matériels soit en quelque sorte défectueuse.
Confucius fonde sa morale sur l’invariable milieu ou juste milieu.
L’excès et le défaut étant l’un comme l’autre également répréhensibles.
Pour Confucius l’homme a deux parties ; une partie inférieure dominée par les passions et une partie supérieure orientée vers la sagesse qui déterminerait une voie droite.
Cela fait penser aux conceptions antiques de la philosophie faisant intervenir une partie de l’âme proche du corps, des pulsions et des passions et une autre partie de l’âme, partie activée, orientée vers le Bien et le Beau comme dirait Platon.
Ainsi la voie du serpent serait responsable d’une sorte de dégénérescence ou d’atrophie de la partie supérieure de l’âme.
Enfin certaines traditions initiatiques donnent un autre aperçu de la question et notamment lors de l’ouverture d’une certaine porte.
La fameuse porte qui marque le fait d’être au centre de l’idée.
Il y est questions d’un piédestal cubique en marbre blanc sur lequel figurait le Nom Adonaï assimilé à un vain symbole. Le maître retournant la pierre disait à ces disciples « vous êtes au centre de l’idée ».
Les disciples épelèrent alors les inscriptions y figurant ; IOD, HE, VAU, HE.
Être au centre de l’idée.
Une représentation vient, elle m’apparaît, je l’envisage, je l’épouse, c’est-à-dire je la prends avec moi, je la comprends, puis je la laisse disparaître, je m’en dessaisie, elle s’évanouit, elle meurt et je la laisse mourir.
Et cette mort totalement acceptée est ce qui permet à la représentation suivante d’apparaître à son tour.
Et ainsi de suite nous avons la file ininterrompue des représentation naturelles.
Epouser l’idée, la prendre, la comprendre et s’en déprendre.

Et quand il s’agit d’épouser l’idée, comment ne pas évoquer le dieu grec Poséidon.
Poséidon où l’époux de l’idée.
L’étymologie du mot grec Poséidon est Posis eidon ou l’époux de l’idée. La femme de Poséidon est Amphitrite.
Amphitrite est une néréide (fille de Nérée).
Le mot même de néréide se construit à partir de nerth qui signifie en-dessous.
Certains y ont vu une référence à l’Inconscient.
Donc le nom même de Poséidon évoque le mouvement qui, des profondeurs mêmes de l’Inconscient aboutit à la conscience.
Mais attention si Amphitrite est une néréide et évoque l’émergence de l’idée dans la conscience, la structure de son nom avec Amphi qui veut dire les deux nous re-pose le problème de l’ambivalence.
Ainsi des épousailles de Poséidon et d’Amphitrite deux types d’êtres ou idées vont émerger.
Soit des êtres monstrueux, soit les figures idéales de la mythologie, (les héros).
Ce qui fait la différence entre la production du monstre ou du héros, toujours en termes de représentations, c’est bien sûr la capacité à exercer la fonction symbolique ou capacité à rompre, à se déprendre de la représentation.
L’avènement d’une conscience claire et lumineuse implique que les épousailles des idées ne créé pas d’attachement aux idées.

En résumé de ce qui a été dit, il s’ensuit, de tous les aspects évoqués plus haut tant mythiques que philosophiques, que pour pouvoir cheminer sur l’axe vertical, axe de la transcendance mais aussi axe ontologique, il faut effectuer un sacrifice, une sorte de réduction phénoménologique comme dirait Husserl.
Ce sacrifice, cette réduction, nous situe au centre de l’idée.
Ce centre de l’idée est indissociable d’une dimension temporelle qui est l’instant.
Oui la réduction à laquelle nous sommes conviés nous assigne l’obligation de nous situer dans le présent.
Oui obligation est faite de nous maintenir au cœur de ce qui vient, au cœur de ce qui se présente à nous, comme diraient les stoïciens.
Et ce qui se présente à nous, ce qui vient à nous c’est le surgissement de la représentation, de l’idée.
Cet instant là est la seule chose qui nous appartient. C’est cette façon d’être présent qui prend le pas sur la dimension purement temporelle du présent.
C’est assurément cette façon d’être présent au cœur du processus idéique qui nous centre et nous ouvre la porte de l’être.
Ce présent-là est un vrai présent qui nous permet de trouver notre centre synchronisé avec le Centre.
Et ce centre qui coïncide avec le Centre est le lieu même de l’unité et de l’harmonie entre le Ciel et la Terre.
Les hommes sont aliénés par l’inconnaissance de ce présent-là.
Ils ignorent ce seul lieu où ils peuvent être eux-mêmes authentiques, vivants et libres.
Seul ce présent est notre pouvoir.
Car en ce centre, en ce cœur, en ce point d’intersection de la croix, il y a le feu du sacrifice, le feu de l’être.

Et n’oublions pas que la croix en bois dans les premiers temps était l’instrument qui permettait de faire le feu. N’oublions pas la troublante similitude entre Agni le feu créé en cette croix et l’agneau, l’Agnus Dei de la tradition chrétienne, immolé sur cette même croix. Cette assimilation du feu au sacrifice est peut-être ce qu’il y a de plus fécond pour bien comprendre la symbolique de la Croix.
Le feu était produit en Inde par le mouvement circulaire d’un bois dur dans un bois plus tendre.
Ces bois pouvaient être de grande dimension et la pièce de dessous pouvait avoir la forme d’une croix.
Il est dit dans le Rig-Védaque des doigts des officiants actionnant la courroie naissait le fils du Charpentier, c’est-à-dire le feu.
Le mot charpentier est troublant et vient renforcer la probabilité d’une assimilation fort ancienne de l’agneau du sacrifice et de l’Agni, le feu, survenant au centre de la croix.
Ainsi Maya, le Charpentier et Agni (le feu) et Marie, le Charpentier et Agnus.
Et le feu des Veda était en coïncidence avec le feu originel de la création du monde, le feu même d’Héraclite.
On voit bien que faire le feu, sacrifier et régénérer sont mythiquement sur une ligne absolument identique.
Et sacrifier par le Feu est le sens même du mot alchimie !
Et cet instant, ce point, ce cœur, ce sacrifice, cette renaissance, ce feu, tout cela se trouve réunit dans un symbole qui est le symbole de la rose.
La rose est le symbole même de la régénération.
Preuve en est que dans l’Antiquité on déposait des roses sur les tombes et les Anciens nommaient cette cérémonie du nom de Rosalia.
Et Jung en personne a assimilé la rose à un symbole solaire ce qui accentue encore pour nous la symbolique du feu.
En cet instant donc de la présence à soi, tout se joue. C’est là, que le mot maintenant prend tout son sens.
Car maintenant est le mot même de l’action.
Et c’est le temps où nous pouvons œuvrer.
Car pour Faire, assurément il faut Être.
